S... UN JEUNE HOMME SAAMAKA (1)
26/12/2013
« Civilisé, mais qui garde sa culture comme elle est »
 Avant-propos
Avant-propos
S... est un jeune homme vivant dans lOuest de la Guyane. Il se définit lui-même comme : « un jeune homme, civilisé, mais qui garde sa culture comme elle est ». Il fait partie du groupe Saamaka (Saramaca), un des principaux groupes sociaux issus du marronnage, présent principalement au Suriname et en Guyane. Il a grandi au bord du fleuve Maroni, sur sa rive Surinamaise. Né d'un père guyanais et d'une mère surinamaise, élevé dans ses premières années par sa tante, tous sont Saamaka et soit Français soit Surinamais. Savoir cela permet d'isoler un certain nombre de problématiques liées à la question de l?immigration, légale ou non, et à celle de l'insertion sociale. J'ai connu S...  alors qu'il était en recherche d'emploi et que j'étais en situation de lui permettre de travailler. Dès le début nous avons parlé, conversé, échangé, sympathisé. J'avais alors depuis un certain temps l'idée de mener un travail d'élucidation relatif aux fractures socio-culturelles et aux ponts susceptibles de les enjamber. Ce qui est rapporté ici n'est pas un travail de recensement des pratiques culturelles ou religieuses, d'autres l'ayant fait mieux que moi. Il s'est agi plutôt de saisir toutes les articulations qui, à la fois, ancrent le jeune homme dans sa culture et le placent dans une dynamique d'inclusion (et non d'assimilation !) dans la société occidentale moderne. Le résultat du travail que nous avons mené ensemble, S... et moi, ce sont des entretiens enregistrés puis transcrits. Je n'ai pas, pour ma part, une formation spécifiquement anthropologique, encore moins ethnographique, ce qui pourra, à propos de la forme, gêner plus d'un spécialiste pointilleux. Mes seules « techniques » de recherche ont été l'attention, le questionnement, l'écoute et la réciprocité de l?échange.
alors qu'il était en recherche d'emploi et que j'étais en situation de lui permettre de travailler. Dès le début nous avons parlé, conversé, échangé, sympathisé. J'avais alors depuis un certain temps l'idée de mener un travail d'élucidation relatif aux fractures socio-culturelles et aux ponts susceptibles de les enjamber. Ce qui est rapporté ici n'est pas un travail de recensement des pratiques culturelles ou religieuses, d'autres l'ayant fait mieux que moi. Il s'est agi plutôt de saisir toutes les articulations qui, à la fois, ancrent le jeune homme dans sa culture et le placent dans une dynamique d'inclusion (et non d'assimilation !) dans la société occidentale moderne. Le résultat du travail que nous avons mené ensemble, S... et moi, ce sont des entretiens enregistrés puis transcrits. Je n'ai pas, pour ma part, une formation spécifiquement anthropologique, encore moins ethnographique, ce qui pourra, à propos de la forme, gêner plus d'un spécialiste pointilleux. Mes seules « techniques » de recherche ont été l'attention, le questionnement, l'écoute et la réciprocité de l?échange.
Puisqu'il me faut bien apporter quelques précisions sur la forme, disons que j'ai essayé de « polir » la parole de S... (qui s'est exprimé en français la plupart du temps) sans chercher à en faire une langue syntaxiquement ou grammaticalement correcte. Par exemple, j'ai rétabli systématiquement tous les ne (négation) qui font cruellement défaut à l'oral, - y compris d'ailleurs chez nos compatriotes francophones de langue maternelle -. Ensuite, l'emploi qui parfois semblait indéterminé du présent, de l'imparfait et du passé composé m'a plongé plus d'une fois dans l'embarras. Mais cela est symptomatique d'une construction intellectuelle du temps différente de la nôtre (parfois même le présent est utilisé pour rapporter une action passée, mais s'étant répétée ou ayant été habituelle). J'ai donc opté pour le respect du code français d'utilisation des temps de conjugaison : un événement qui dure est rapporté le plus souvent à l'imparfait de l'indicatif, une action terminée au passé composé.
Enfin, ainsi que je l'ai écrit supra, ce que je rapporte ici relève plutôt de l'entretien que du seul questionnement. Cela expliquera que ma parole rapportée prenne parfois une place assez importante dans la relation.
La motivation qui m'a animé pour mener ce travail d'écriture (à une main) mais aussi de réflexion et d'élucidation (à deux cerveaux) est d'œuvrer pour une meilleure connaissance mutuelle qui pourra entraîner, de chaque côté, compréhension et acceptation de l'Autre, bien au-delà de la simple tolérance qui n'oblige aucunement à l'empathie, encore moins à la construction commune d'un projet sociétal. Si ce modeste travail avait l'heur d?interpeller le lecteur sur les ambigüités de slogans appelant au rejet de l'autre, nul doute que des notions hautement médiatisées, telles par exemple l'immigration incontrôlée ou le (considéré comme tel) refus d'intégration, tomberaient d'elles-mêmes du haut des remparts fictifs érigés par ceux dont le pouvoir repose sur la défiance, la méconnaissance voire la haine de l'Autre. C'est là le combat de l'honnête homme, le combat du citoyen.
* * *
Encore très proche, déjà si lointaine… L’enfance
- S..., pour commencer cette série d’entretiens, il nous faut commencer par le début. Veux-tu me parler de tes souvenirs les plus lointains ?
- Je me souviens que j’habitais dans… sur le fleuve, à Grand Santi. Je me souviens, on allait pêcher, il y avait l’abattis…
- Tu avais quel âge, à ce moment-là ?
- Sûrement au moins cinq ans…
- Tu n’as pas de souvenirs plus vieux ? Avant cinq ans ?
- Si, j’avais quatre ans.
- Quatre ans ? Est-ce que tu as des souvenirs de ce moment-là ? Ce que tu faisais, avec qui, avec ta mère ?...
 - On allait à l’abattis, mais c’était avec ma tante, parce que je n’habitais pas avec ma mère. Ma mère, elle était en Guyane, et moi…
- On allait à l’abattis, mais c’était avec ma tante, parce que je n’habitais pas avec ma mère. Ma mère, elle était en Guyane, et moi…
- Mais Grand-Santi, c’est en Guyane ?
- Oui, mais j’habitais à côté de Grand-Santi. Mais ce n’était pas vraiment Grand-Santi, c’était en face, sur le côté Suriname. J’habitais avec ma tante, qui était médecin, et avec son mari. On allait à l’abattis…
- Excuse-moi, je t’interromps mais j’ai une question. Tu m’as dit que ta tante était médecin, c’est une profession qui est, en principe bien payée, mais elle faisait quand même son abattis ?
- Voilà. Elle a toujours voulu garder ce qu’elle faisait avant, quand on était tout petits, avec sa mère elles allaient à l’abattis, et c’est ça qui lui a permis de payer ses études. Alors bon, elle voulait toujours garder ça, alors elle l’a gardé. Nous on la suivait, avec ses enfants, et moi aussi…Elle allait à l’abattis les jours où elle ne travaillait pas, c’est-à-dire les week-ends, parce que, les week-ends, on ne va pas à l’école. On revenait tard l’après-midi, on emportait à manger, on restait là-bas jusque tard l’après-midi. Après on revenait avec des sacs sur la tête…
- Des sacs de ?...
- De dachines, de manioc, de pindas, des trucs comme ça, voilà. Il y avait toujours quelque chose à rapporter. J’avais mon petit champ à moi, où je plantais ce que je voulais.
- Alors, tu plantais quoi ?
- Alors, je plantais dachine, manioc, et je ne sais pas comment on appelle ce manioc-là, qui a un goût sucré…
- Le cramanioc ?
- Voilà. Le cramanioc. Celui-là, on le mange comme ça. L’autre manioc, qu’on n’avait pas le droit de planter, [nous, les enfants], c’était celui avec lequel on faisait du couac. Parce que celui-là, il était amère, il était toxique. Alors les enfants n’avaient pas le droit de planter ça. Par contre, les pistaches, quand on les récoltait, on les cassait à la main, et on en remplissait des bidons, des bidons de pistaches… Ça prenait des journées, ça pouvait prendre huit jours. Les gens d’à côté venaient casser les pistaches avec nous. Quand on avait fini de les casser, on les faisait cuire, on retirait la deuxième peau, tu sais, ce n’est pas épais, c’est…
- Oui, il y a d’abord une coque, puis une peau…
- On retirait ça, puis on écrasait pour faire la pâte. On le gardait dans des seaux, des seaux bien fermés, puis on emportait ça au Suriname. En fait, on vendait, on faisait le commerce.
- Donc, l’abattis, ce n’était pas seulement pour votre consommation, c’était aussi pour vendre ?
- Voilà.
- Il y avait alors le salaire de ta tante qui était médecin, il y avait l’abattis… Est-ce qu’il y avait d’autres choses qui aidaient à vivre ?
- En fait, c’était surtout l’abattis…
- C’était pour gagner de l’argent, ou pour manger ?
- C’était surtout pour manger. Parce qu’on était loin de la ville, parce que c’était cher. C’était très cher, mais c’est encore plus cher quand on habite loin de la ville, parce qu’on est obligé d’aller là-bas en pirogue ou bien en avion.
- Tu m’as dit que tu étais en face de Grand Santi. Maintenant il y a là un terrain d’aviation, mais avant il n’y en avait pas.
- De toute façon j’étais de l’autre côté. Mais des fois on allait à Grand Santi pour acheter… des trucs. En fait, on n’utilisait pas l’argent du Suriname. D’abord, on utilisait le Franc, pour faire des achats, et l’or, aussi, on achetait avec ça. Pour faire ses achats avec l’or, on le pèse, et après, on compte, il y avait des machines pour ça.
- Mais, l’or, vous le trouviez comment ?
- Eh bien, on l’achetait, ou bien quand des gens venaient acheter des trucs chez nous, ils nous payaient avec de l’or. Après, on pouvait racheter des choses avec cet or.
- C’était comme s’il y avait deux monnaies, en fait…
- Oui, l’argent et l’or.
- Et les gens préféraient plutôt l’argent, ou plutôt l’or ?
- En fait, ça dépendait. Ça dépendait parce que… des fois ils vendaient des bidons de carburant, des trucs comme çà… Pour le carburant les gens préféraient l’or. Tu l’achetais en grande quantité, quoi, cent litres au moins. Tu payais ça en or. C’est plus sûr, tu n’as pas à te balader avec beaucoup d’argent sur toi.
- Ça se cache plus facilement qu’un gros paquet de billets ?
- Oui.

- Tu avais quel âge ?
- J’avais déjà au moins cinq ans !
- Ah oui, déjà à cinq ans tu jobais[2] pour…
- Ah oui, je faisais plein de choses, je plongeais, je nageais dans le courant, j’allais ramasser des choses pour eux… En fait, j’ai failli… j’ai failli me noyer plusieurs fois, parce que parfois le bateau se renversait…
- Et… ta tante, elle était au courant de ça, de ce que tu faisais ?
- Ben… des fois oui, des fois non (rire)…
- Tu as dû te faire corriger plusieurs fois, non ?
- Ah, oui, ça c’est normal, c’est l’habitude, chez nous. Tu es corrigé à chaque fois que tu n’écoutes pas. C’est une habitude, c’est une méthode pour élever les enfants. Voilà, c’est toujours comme ça.
- C’est vrai que, à cinq ans, si tu vas plonger dans un saut, ou sous une barge qui risque de se renverser, tu prends un risque énorme, tes parents vont te perdre…
- De toute façon, je ne veux pas que mes enfants fassent ça. Une fois, ma tête a cogné sur une grosse pierre [un rocher]. J’ai plongé, je me suis cogné, et je me suis réveillé sur le bord de la mer[3][du fleuve], pris dans des buissons. Je me suis réveillé là. C’est là que je suis revenu
- Donc tu as été assommé ?
- J’ai été assommé.
- Et c’est quelqu’un qui t’a sorti, ou bien c’est l’eau qui t’a rejeté ?
- C’est l’eau qui m’a rejeté. J’ai eu de la chance. Parce qu’il y avait l’eau, je ne sais pas comment on appelle ça, des petits tourbillons, là, tu vois ? Ça t’emmène au fond, c’est plein de pierres, tu te cognes dessus. Tu peux rester coincé… Moi, en fait, ça m’a repoussé, jusqu’à ce que je me retrouve dehors, sur le bord. À côté de la mer. Je rêvais, je me demandais où j’étais… C’était bizarre… je me croyais perdu : « je suis où, là, je suis où ? » Il m’a fallu vraiment un grand moment pour comprendre ce qu’il s’était passé (rire). C’est après que j’ai eu peur… J’ai eu peur, mais ça n’a rien changé… (rire)
- Tu as eu peur mais tu as continué ?...
- Bien sûr, j’ai continué… On faisait des jeux, dans l’eau, comme d’habitude, avec les petits jeunes [les enfants], puis il y avait des grands, qui en arrivant nous foutaient des coups de fouet, ils étaient obligés de nous fouetter, pour nous faire comprendre que, voilà, ça suffisait comme ça, il y en avait assez. J’avais des blessures un peu partout.
- Et, donc, quand tu jobais pour les orpailleurs, ils te donnaient un peu d’argent, un peu d’or ?
- Pas d’argent, de l’or. De l’or, seulement.
- Donc, tu avais cinq ans, tu gagnais déjà de l’or !
- Oui, j’avais mon or à moi, rangé dans un truc. Mais après, c’est ma tante qui gardait ça. Parce qu’il y avait des petits jeunes qui se faisaient harceler, qui prenaient des coups, qui étaient blessés, qui se faisaient voler leur or sur eux…Moi, je m’en foutais. Je me disais : « je le gagne, et ma tante le garde pour moi ». Ma deuxième maman.
- Alors, ta maman ?
- Je ne voyais pas ma maman tout le temps. À ce moment-là, ma mère, elle était déjà partie pour vivre ici, à Saint-Laurent. Mais un jour elle est revenue vivre au Suriname. Mais avec mon père. Elle était en Guyane et en même temps au Suriname.
- C’est le moment où ils se sont connus ?
- Non, ils se connaissaient déjà. Mon père est venu au Suriname, et c’est après qu’il a connu ma mère. Puis ils sont repartis ici [à Saint-Laurent]. Ma mère, elle, venait de finir ses études, mais ma tante voulait absolument me garder. Alors elle a dû me laisser, parce que c’était sa grande sœur, c’est comme ça. Ma tante, elle gagnait bien sa vie, déjà. Elle pouvait faire ce qu’elle voulait, et du coup… je suis resté avec la sœur de ma mère, et j’ai grandi avec ses fils.
- Et tu as eu tes frères après ?
- Après, oui.
- Et donc, tu as vécu loin d’eux ?
- Voilà. Mais je les voyais, je les voyais souvent. On allait presque toutes les vacances habiter au Suriname, soit en avion, soit en bateau. Moi, je préférais le bateau [la pirogue]. Parce que c’était plus amusant, on prenait deux jours pour aller au Suriname. On s’amusait dans le bateau, on s’arrêtait dans les villages, on regardait les paysages…
La vie était différente, pour nous. Et puis, on était plus tranquille, avant, je trouve… Là-bas, les enfants, jamais ils ne vont à Paramaribo, mais ils habitent parfois, pendant longtemps, chez des amis. C’est pour voir la vie, pour voir comment c’est…
Il est remarquable, ici, de noter l’utilisation « décalée » de certains repères spatiaux et temporels…
« On allait presque toutes les vacances habiter au Suriname » : sans doute l’intérieur du Pays, ou bien le Pays Saramaka, Paramaribo, etc. par opposition à la vallée du fleuve, les deux rives comprises, zone considérée intuitivement par ses habitants comme un pays spécifique, au fond ni tout à fait Suriname, ni tout à fait Guyane… Nous le vérifierons plus loin.
Il est étonnant par ailleurs d’entendre dans la bouche d’un garçon de 23 ans que « la vie était différente, avant »… Comment expliquer cela ? S... a-t-il perçu intuitivement la pénétration d’une assimilation galopante, accompagnée de réglementations toujours plus contraignantes ? Ou bien garde-t-il la nostalgie d’une enfance en liberté, bien que cadrée ?
- Pour l’abattis on a toujours gardé le même système. Par exemple, tu as trois grandes personnes avec chacune sa famille. Quand la première va à l’abattis, les parents d’à côté disent à leurs enfants : « allez les aider ! ». Et ils les suivent, ou bien même les parents y vont. Un autre jour, c’est l’autre qui y va, et tout le monde va l’aider.
- Et c’est un abattis communautaire, ou chacun a le sien ?
- C’est un abattis différent.
- Donc, chaque abattis appartient en propre à quelqu’un mais est cultivé par plusieurs personnes ?
- C’est le plus souvent ça. Pour le plus dur, en tout cas. L’abattage, l’arrachage du manioc, la plantation… Il faut faire plein de trous dans la terre…
- Ça se replante à quel moment, alors ? Et comment ça se passe ? il faut prendre un morceau de racine ?
- Non, non. C’est l’arbre [la tige] que tu prends. Elle a fait des « gosses » [des rejets] et c’est ceux-là que tu replantes.
- Mais il n’y a même pas un morceau de racine qui reste attaché après ?
- Non. Il n’y a pas de racine. C’est ça seulement qui pousse.
- Et à quel moment ça se plante ?
- La « déforestation », c’est pendant les grandes vacances, à la saison sèche. Et on brûle aussi pendant la saison sèche. Parce qu’il n’y a pas de pluie. Et pensant que ça brûle, on nettoie, on aménage l’abattis. Et, le temps de nettoyer, c’est déjà la saison des pluies. Alors on commence la plantation : le manioc, le cramanioc, les cacahuètes, le maïs…
- Donc, c’est quand il commence à pleuvoir…
- Voilà. C’est là qu’ils font leurs plantations.
- Et ils récoltent à quel moment ?
- Ouf ! j’ai un peu oublié… Mais c’est la même année, presque à la fin de l’année. On récolte pour replanter.
- Donc, vers la fin de la saison des pluies, on récolte à la fois pour manger et pour vendre, et à la fois pour replanter… Je pense qu’on réserve une partie pour manger et une partie pour vendre, et on plante les jeunes pousses.
- Exactement. On tire ça, après on fait du couac[4]. Avec le cramanioc, on fait autre chose. C’est pour ça qu’on n’en plante pas beaucoup, du cramanioc, c’est surtout pour la famille, ou bien vendre un peu. Mais le manioc amer qu’on avait surtout, on faisait le couac avec.
- Le couac, et puis les cassaves ?...
- Non, les cassaves, on fait ça avec du cramanioc[5]. On n’a pas besoin d’en planter beaucoup, comme le « manioc amer ». Le manioc amer, on est obligé d’en planter beaucoup, pour faire le couac… des tonnes et des tonnes (rire).
- Et c’est vendu au fur et à mesure, ou bien vous le mettez de côté, vous le gardez dans des caisses ?
- On le garde.
- Et ce n’est pas mangé par les bêtes, par les insectes ?...
- Non, ce sont de gros bidons bien fermés. C’est bien conservé. Et ça se vend vite. À peine fini, il n’y en a plus, déjà. Ça se vend bien, ça part vite. Mais ça demande beaucoup de travail, aussi. Mais… du coup, on a des bénéfices, sur ça.

- C’est dur, très, très dur. Franchement même, c’est trop dur ! (rire).
- Et, en même temps, il n’y avait pas le choix, il fallait manger…
- Et, en même temps, on faisait ça comme ça, par plaisir, parce que nos parents, ils aimaient… Alors, du coup on faisait… on obéissait et… on appréciait. Et, puis c’était la nourriture de tous les jours, mais on aimait bien, ça. Moi, par exemple, j’aime bien prendre du couac avec du sucre. Je le mange. Et puis, je n’ai plus besoin de rien. On allait à la pêche, aussi, On faisait nos outils, on faisait des pirogues, des pagaies, des trucs comme ça, pour la pêche.
- Quand tu dis « on faisait des pirogues », tu fabriquais des pirogues ?
- Voilà, on fabriquait des… moi, je fabriquais la mienne, aussi, moi tout seul. Ce truc-là, on l’appelle le wiliboto. C’est à une place… pour une seule personne. Tu fais ça pour toi tout seul, avec un bois spécial, j’ai oublié comment il s’appelle. En fait, il y en a plusieurs, ce n’est pas qu’un seul. Mais tu creuses, tu « fais ton bois » tout seul.
- Et tu le brûles[7], aussi ?
- Non, tu ne le brûles pas. Celui-là est un bois léger. Tu es comme ça (il montre la position, assis jambes allongées devant lui), tu pagaies d’un côté, puis de l’autre côté. Tu es obligé de pagayer des deux côtés.
- Ce sont des pagaies doubles ?
- Voilà. Pour garder l’équilibre. Parce que le bateau, ça faisait ça (geste indiquant un double mouvement, de roulis et de zig-zag). C’est un truc pour garder l’équilibre, parce que sinon, tu tombes [à l’eau]. C’était amusant, on faisait des courses.
- Je me rappelle avoir vu, au Brésil, sur l’Amazone, des indiens qui avaient de petits bateaux, un peu comme celui que tu décris…
- Avec une seule personne ?
- Avec une seule personne, mais ça dépassait à peine de l’eau (geste d’empan avec la main indiquant six à huit centimètres). J’aurais eu une de ces peurs…
- Voilà, c’est ça. « Ça, là » [ce que tu montres], c’est grand, déjà. Nous c’était moins. Mais les petits jeunes, on gardait l’équilibre, je gardais l’équilibre, je traversais, on faisait des courses…
- Donc, le wiliboto, c’est juste une pirogue pour traverser…
- Voilà. Ce n’est pas pour aller à la pêche…
- Oui. J’imagine que si tu jettes le filet depuis là, tu vas tomber à l’eau (rire).
- Voilà. Mais on avait tellement l’équilibre qu’on n’avait même pas besoin de pagayer, on restait au fond [du bateau], on gardait l’équilibre comme ça. En fait, c’était dur, dur d’apprendre. Au début, j’écoutais les gens, j’essayais plusieurs fois, mais je n’y arrivais pas (rire). C’est après que j’ai réussi, après c’est allé tout seul…
- OK. Merci. Je pense qu’on va faire une petite pause…
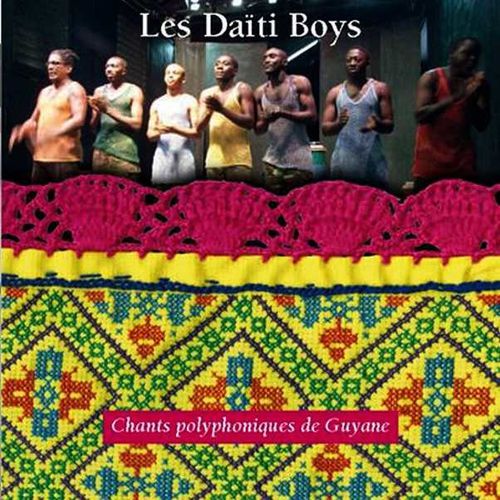
[1] Les barges d’extraction, où les orpailleurs travaillent et vivent avec leur amille.
[2] Jober, barbarisme local pour dire que l’on fait des petits jobs, des « petits boulots ».
[3] Dans l’acception locale désigne une très vaste étendue d’eau, salée ou non. En fait le terme fleuve n’existe pas. Tous les fleuves, aussi larges soient-ils, sont désignés par le terme rivière, à l’exception du Maroni que dans l’Ouest on nomme « Le » Fleuve. De la même façon les rivières ou ruisseaux sont désignés par le terme crique.
[4] Manioc râpé, puis égoutté par pressage dans des vanneries tressées appelées « couleuvres », afin d’en extraire le jus toxique. Séché, il prendra l’aspect de petits granulés. Il est consommé tous les jours, humecté par la sauce d’un plat cuisiné ou simplement trempé d’eau.
[5] Le cramanioc est une variété de racine proche du manioc, mais non toxique et de forme plus allongée.
[6] Grande plaque métallique rappelant un peu les crêpières bretonnes anciennes que l’on plaçait sur un lit de braises. Mais les platines peuvent atteindre 1,50 m ou 2 m de diamètre.
[7] Le brûlage est l’opération qui consiste à brûler l’intérieur du tronc évidé en y versant de la braise afin de le durcir et de le rendre plus imperméable.
A découvrir aussi
- LES TEMBEMAN DE LA COLLECTION MAMA BOBI (2)
- AMÉRINDIENS DE GUYANE : QUI SONT-ILS ?
- LES MARRONS DE GUYANE FRANÇAISE, POPULATION EN EXIL ET DIEUX EN PÉRIL (2)
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 93 autres membres


